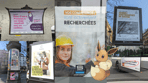La dictatrice, les assistants maternels et les violences faites aux femmes
Cette semaine, les murs des villes se recouvrent d'affiches pour dénoncer les violences faites aux femmes. C'est indispensable. Et c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux différentes manières de parler de la majorité (celle qui subit, celle qui agresse, ou simplement celle qui agit) dans la perspective d'un langage inclusif.


Le 25 novembre, c’est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une journée importante de mobilisation dans le monde entier. A cette occasion, à tous les échelons du local au global, de l’associatif au gouvernemental, sont produits des supports de communication pour sensibiliser le grand public et faire connaître les actions menées. Au premier rang de ces supports, des affiches qui seront visibles dans l’espace public et qui permettent de s’intéresser à deux questions au croisement du langage inclusif et du discours politique : comment parler des groupes qui sont très majoritairement composés de personnes d’un seul genre ? Faut-il édulcorer le discours sur les violences sexistes et sexuelles pour mobiliser sans cliver ?
La dictatrice et les assistants maternels
Ce qu’on cherche en premier lieu quand on pratique les principales conventions du langage inclusif dans la perspective de dégenrer la langue, c’est de ne pas avoir recours au masculin dit générique (celui qui est censé être neutre pour le Président de la République). Quand on parle de groupes mixtes, on pourra utiliser différents outils pour l’éviter comme les doublets (“Françaises, Français”, formulation omniprésente chez ce même président, bizarrement), les termes épicènes (les journalistes), englobants (le personnel soignant) ou dans certains cas où la lisibilité des mots n’est pas trop compromise, le point médian (qui est totalement optionnel mais pratique dans certains contextes).
Une application littérale de ces conventions pourrait mener une personne de bonne volonté à bannir définitivement le masculin grammatical dès lors qu’on parle, au pluriel notamment, de groupes mixtes : en utilisant les doublets, par exemple, on dirait “les plombiers et les plombières” comme on dirait “les dictateurs et les dictatrices” ou les “agresseurs et les agresseuses”. Or dans le cas de groupes qui sont très majoritairement composés de personnes d’un seul genre, comme les dictatures en écrasante majorité menées par des hommes ou les métiers ultra féminisés de la petite enfance comme assistante maternelle, est-il pertinent de renoncer au choix d’un seul des deux genres ? Faut-il vraiment se forcer à parler des dictatrices et des assistants maternels ?
Pratiquer un langage inclusif, c’est avant tout cultiver son esprit critique sur les mots qu’on emploie pour sortir d’un mode d’expression automatique où le masculin règne : mais cet exemple est une excellente illustration que les grandes conventions du langage inclusif sont là pour nous guider, pas pour servir de règles immuables et rigides à appliquer sans réfléchir (et en ce sens, c’est bien plus enrichissant que les règles souvent arbitraires de notre orthographe française que les Linguistes atterré·es, entre autres, appellent à simplifier).
Rappelons-nous quels problèmes le langage inclusif cherche à résoudre : d’abord, le langage inclusif permet de réduire les ambiguïtés de sens que crée le masculin dit générique (parfaitement illustrées par cette publicité Monoprix où on ne comprend simplement pas à qui on parle). Ensuite, il permet de rendre visibles les femmes là où le masculin dit générique a tendance à renforcer les représentations masculines dans notre cerveau.
Si l’on revient à notre exemple, quels problèmes cherche-t-on à résoudre ?
Est-il nécessaire de rendre visibles les quelques dictatrices qui ont existé (dont le statut même de dictatrice est discutable si on omet le féminin conjugal des femmes de dictateurs) ? Quel cause cela fait-il avancer ?
Est-il nécessaire de rendre visibles les quelques assistants maternels en activité (0,6% en France en 2020, selon l’Observatoire de l’emploi à domicile) ? Ou faut-il assumer d’employer le féminin pour représenter la réalité ?
C’est une question plus délicate : car on pourrait avoir envie justement de faire exister dans la langue la possibilité que ce métier soit exercé par un homme pour, si ce n’est créer des vocations chez les petits garçons, au moins contribuer à lever les résistances à envisager une carrière dans les métiers du soin, en écrasante majorité exercés par des femmes.
Visibiliser ou invisibiliser, that is the question
Quand on parle de métiers ou de fonctions où un genre est surreprésenté, on est face à une alternative :
- accepter d'invisibiliser une partie plus ou moins grande des personnes qui l’exercent au nom de la majorité pour s’aligner avec la réalité, comme pour les assistantes maternelles.
- choisir délibérément de faire exister le masculin et le féminin pour susciter des représentations des deux genres et casser les stéréotypes liés aux métiers, comme les plombiers et les plombières (toutes les méthodes du langage inclusif ne se valent d’ailleurs pas pour créer ces représentations, les techniques de neutralisation comme les mots épicènes ou englobants étant moins efficaces).
Et je vous dis tout de suite qu’il n’y a de choix qui soit bon ou mauvais dans l’absolu. Ce choix peut varier en fonction du contexte (oui, toujours lui).
...