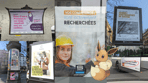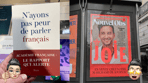Le genre des slogans, impensé de la publicité
La dernière campagne de Danone pour les jeux de Paris 2024 a pour slogan "Champions à tous les âges de la vie" alors qu'elle met en avant une majorité de "championnes". Un exemple intéressant pour illustrer un impensé de la publicité : le genre des mots des slogans.


Je suis tombée dans la rue l’autre jour sur une des affiches de la campagne de Danone pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : on y voit une jeune femme handicapée qui porte une prothèse, Typhaine Soldé, faire du saut en longueur. En surimpression, le slogan « Champions à tous les âges de la vie ». Cette affiche fait partie d’une campagne comportant 3 créations publicitaires différentes : celle que je viens de décrire, une autre où un vieil homme fait du skateboard et une dernière où une petite fille fait de l’escalade. Je trouve cette campagne très intéressante parce qu’elle est emblématique d’un impensé en publicité : le genre des mots employés dans les slogans.

Le masculin dit générique est une croyance limitante
Le premier problème que me pose ce slogan est qu’il crée chez moi une forme de dissonance de genre image / texte : on me montre une image de femme et un texte qui parle d’hommes. Le désalignement des genres représentés à l’image et dans les mots me heurte. Je sais bien qu’en tant que partisane du langage inclusif, j’ai un regard particulièrement critique et sensible et que pour la plupart des gens, c’est tout simplement invisible. Car nous baignons, depuis notre enfance, dans le masculin dit générique, ce masculin grammatical qui est censé représenter tout le monde. Ce masculin qui aurait une double valeur : le masculin spécifique des humains de genre masculin (comme dans « Le président s’est approché de l’estrade ») et le masculin dit générique ou neutre des groupes mixtes (comme pour parler du « groupe de musiciens » censé représenter aussi bien One Direction composé de 4 hommes, que The White Stripes, 1 femme et 1 homme). Sauf que l’idée même de l’existence de la valeur générique du masculin est une forme de croyance limitante, c’est-à-dire de pensée que nous avons, dont nous nous sommes convaincu·es et qui nous freine, nous limite. J’emprunte cette expression à l’univers du coaching car elle me semble pertinente pour qualifier les dommages opérés par l’utilisation systématique du masculin pour parler des groupes mixtes, dommages qui ont été documentés par des décennies d’études scientifiques dans le champ de la psycholinguistique, qui ont démontré que le genre grammatical masculin convoque, dans l’esprit des gens, des représentations masculines. Un chiffre le prouve (issu de l’étude Google x Mots-Clés « Observatoire de l’opinion et des interrogations des internautes sur l’écriture inclusive en France en 2021 ») : demandez à deux groupes de personnes de citer « 2 écrivains célèbres » et vous aurez 3 fois moins de noms de femmes citées que si vous utilisez une formulation de question inclusive : « Citez 2 noms d’écrivains ou écrivaines célèbres ». CQFD
Donc oui, le masculin dit générique est une forme de croyance limitante parce qu’il limite une chose très simple, rendre visible les femmes, parce qu’on croit que le masculin le permet.
Et quand Danone fait l’effort manifeste de mettre des femmes en avant dans une campagne, c’est vraiment dommage de ne pas aller au bout de la démarche.
L’écrit, bastion prestigieux du masculin
Ces affiches s’inscrivent dans le cadre d’une campagne qui comporte aussi un volet vidéo. Quelle n’a pas été ma surprise quand j’ai constaté que contrairement à l’affiche, la voix off de la vidéo de la campagne n’utilisait pas ce fameux masculin générique mais le logique féminin pour la jeune femme handicapée et la petite fille qui fait de l’escalade. On y entend bien « Pour permettre à toutes de devenir une championne ».
...